Frappe, frappe mais ne frappe pas à ma porte
J’ai toujours eu peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir, je sais. J’avais une frousse bleue de la mort. Parfois lorsque je suis seule, j’essaie de créer un scénario dans lequel je mourrais. Horrible. Mon cœur qui s’arrêtait de battre, mon cerveau qui se court-circuite et mes yeux dans lesquels s’appesantissaient d’effroyables ténèbres aux ailes vertigineuses. Je me retrouvais toujours en sueur après avoir imaginé tous ces scénarios. Malgré tout, mes questions restaient néanmoins sans réponse : quelle sensation aurai-je quand je mourrai ? Aurais-je le temps de penser à tout le monde ? Aurais-je le temps de corriger mon testament ? Aurai-je le temps de me souvenir de mon dernier orgasme et des autres que j’allais rater ? Aurais-je le temps de prier pour mon âme avant que l’enfer n’en fasse qu’une bouchée ? N’ayant pas toujours eu un gros cerveau durant ma vie, je ne crois pas qu’elle allait se transformer en super ordinateur pour parcourir des années d’existence en quelques millisecondes. La mort est un trou noir qui attire tout être vivant indéniablement en son centre. C’est un tueur à sang froid, qui fait comme on lui ordonne de faire son boulot. Il ne traite ni avec la vieillesse ni avec la jeunesse, ce sont des notions qui lui échappent. Elle ne se plie pas sous la volonté du temps mais suit les voies que lui trace le destin. Ce que nous réserve la mort est méconnu. Personne ne s’en est revenu pour nous dire son secret. Aucun scientifique jusqu’ici ne peut nous dire exactement ce qui se passe après que celle-ci s’immisce dans notre vie. Alors on est là, pantelant, à attendre que notre heure arrive pendant que notre conscience est bombardée de fantaisie pour nous pousser à accepter notre sort. Nous sommes conscients de la vie et de la mort et c’est là tout notre problème. Je me demande toujours pourquoi la vie est si courte, c’est l’une des choses qui m’effraie dans toute cette histoire : la durée. Je voudrais tellement avoir une seconde vie ou tout simplement profiter de celle que j’ai maintenant. Je voudrais être immortelle pour ne plus avoir à penser à fermer les yeux définitivement un jour.
Je ne veux pas vieillir, j’aimerais être une éternelle flamme brillant ardemment dans la nuit et dans le cœur des hommes. J’aime quand on me dit que je suis belle. Je sens alors vibrer chaque centimètres carrés de mon corps et un sentiment de béatitude m’envahir comme si on venait de me prier : Sainte-Catherine mère de la baise, pleine de sensualité. Je pourrais baiser avec un homme rien que pour ça. Que le pape me canonise ! J’aime quand je suis sous leurs projecteurs, qu’ils me regardent de manière ludique et que dans leurs têtes mon corps est un saint graal pris dans un étau de fantasmes mort-né. Je serai toujours ce corps auquel il ne faut pas toucher, qu’on ne peut pas toucher simplement parce que je suis trop belle pour être touchée. Je ne fais pas de la baise ma principale distraction, ce n’est qu’une chose qui m’arrive comme ça de temps en temps. Ce que j’aime surtout c’est avoir tous les hommes à mes pieds et qu’ils m’adorent pour baiser avec moi, recevoir leurs offrandes de foutre épicé, de foutre fumant, de foutre en furie comme une déesse païenne. J’aime savoir qu’ils ne dorment sans penser à moi. Je ne veux pas vieillir, la vieillesse est le pire ennemi à ma beauté, c’est un sacrilège sur l’autel de mon corps construit pour tenir l’esprit des hommes en laisse. Et puis, une déesse ne vieillit pas. J’étais persuadée que j’étais une déesse.
J’etais née pour briller. Une étoile, voilà ce que mon père m’avait dit lorsque j’avais gagné le concours de Miss à quinze ans. Ce jour-là, il avait pris mon visage en coupe et m’avait déposé un baiser sonore sur le front, tout en me chuchotant que j’étais belle, que j’étais une étoile. Sais-tu les caractéristiques d’une étoile ? Elles sont lointaines mais cela n’empêche pas leur lumière de vous atteindre. J’avais compris ce que mon père a voulue dire. Je me suis comportée comme une étoile. J’ai recherché la popularité et Dieu seul sait comment le prix à payer peut être énorme. Venant d’une famille aisée, je n’avais aucun mal à me procurer tout ce que je voulais. Cela avait attiré autour de moi un groupe de jeunes filles sangsues, qui faisait les lèche-bottes juste pour gagner un ticket dans une classe sociale à laquelle elles aspiraient. Une classe sociale restreinte et raciste qui ne voulait pas d’elles. Elles devraient apprendre que l’on ne peut changer sa nature en un simple claquement de doigt et accepter leurs conditions feraient d’elles de plus belles lèche-bottes.
Lire aussi>>L’incroyable histoire du meurtre à Thomassin
Je ne savais rien des autres classes sociales sinon celle dans laquelle on m’assignait. Mon père m’en avait parlé un jour : « Ta peau claire, ma chérie, est le plus cadeau que nous, ta mère et moi, ait pu t’offrir dans cette société de brute. Elle détermine fort souvent la classe sociale d’une personne, une classe sociale est un endroit fictif bâti en étages dans lequel on place les gens y compris nous m’a-t-il expliquéen voyant mon airconfus, tant qu’on est dans l’étage le moins peuplé et le plus spacieux tant qu’on est considéré comme des élites. Tu sais ce que sont des élites ? Ceux qui dirigent, ceux qui ont la peau claire comme toi. Tu fais partie de la classe sociale la plus riche et la plus restreinte. Ne te mêle pas des autres gens qui ne sont pas de ton rang. Sais-tu les gens qui ne sont pas de ton rang ? Ceux-là qui ont leurs peaux couleurs de charbon, oui, ces autres que tu vois qui vendent par terre dans la boue quand tu vas au centre-ville, des incultes et des primitifs. » Depuis ce jour, j’avais fait un distinguo entre les gens clairs et les gens foncés. Quoique je n’en montre rien quand je suis au milieu d’eux, je me sens toujours mal à l’aise, on appelle ça du racisme. Je ne sais pas si c’en est un vraiment. Mon père, lui, m’avait dit que c’était normal. Pour en revenir à mes amies, je leur comprenais parfaitement car il n’était pas donné à tout le monde d’être une étoile. J’étais la seule de mon rang qui laissait autant d’astres morts graviter ainsi autour de sa lumière. Plus tard, je connus internet et ses multiples avantages en ligne. Je m’en servis pour grandir ma côte de popularité. Une étoile n’est pas une étoile si elle ne requiert pas l’attention de tout le monde. Alors, j’attirais vers moi leurs regards et je les hypnotisais afin qu’ils puissent rester indéfiniment sur moi. Je me posais nue sur les médias, laissait volontairement entendre toute sorte de rumeur sur ma personne. Je liais d’amitié avec des stars de la musique, j’étais aux premières loges dans tous les évènements chocs de l’année. J’ai même fini sur la couverture d’un magazine qui votait les gens les plus influents de l’année (je soupçonnais un coup monté de mon papa). Influents ? Je n’aimais pas ce mot, je ne voulais pas influencer, je voulais être adorée. Je ne suis pas un modèle et ne le serai jamais. Les gens doivent me regarder et m’envier. Envier ma vie, envier ma richesse. Je voulais qu’ils détestent leurs minables petites vies. Insipide. J’aime la popularité, si pour la grande majorité c’était une entrave à la vie intime et privée. Pour moi, elle était l’univers dans lequel j’allais accrocher mon étoile. Ensuite, la popularité ça ne s’acquiert pas sans une once de petite chamaillerie publique entre copines. J’en faisais presque tous les jours. Dans mon cas, c’était de grands pugilats de mots obscènes. Mon père n’aimait pas mes manières, il avait de plus grands projets pour sa fille.
Il y a certains privilèges que l’on jouisse quand on a un père qui possède le plus grand centre commercial du pays. Dieu merci, je n’ai pas eu à chialer comme la plupart des gens que je croise quand je descends au centre-ville. Il m’arrive d’aller au centre-ville, je déteste le décor, je me demandais comment des gens pouvaient vivre dans de telles crasses. Trop bondés, trop noirs, trop de relents. Trop noir ? Mais bien sûr, la majorité des gens du peuple avait ce teint de goudron sale, luisant à force d’être exposé trop au soleil. Leurs yeux semblaient avoir perdu de leurs éclats et étaient noyés dans une mer de graisse ictérique. Ils souffraient surement d’une maladie incurable, une maladie qui s’était métastasé avec le temps et qui avait laissé des flétrissures dans leurs orgueils. Cela les a rendus indolents, crise identitaire aigue, ils sombraient dans l’abime comateux, avec leurs crasses et leurs imbécilités comme une drogue douce. Ils étaient des rats de laboratoires, condamnés à vivre une vie de réclusion, subissant des scénarios, les uns plus fielleux que d’autres. Ils trouvaient toujours un moyen de s’adapter au mal, ils étaient en manque mais au lieu de réagir, ils se taillaient du confort dans l’inconfort. « Ils sont appelés à disparaitre ces sous-hommes, m’avait-il dit un jour, mais ils ne doivent pas disparaitre car s’ils partent, ils partent avec la corne d’abondance. » J’ai compris plus tard que mon père était une pièce importante dans un engrenage politique qui voulait à tout prix générer des profits à un petit nombre au détriment d’une forte majorité. Le monde de papa m’excitait, il s’agissait d’une manipulation à grande échelle. Il manipulait les élections, influençait les décisions du gouvernement et obtenait des franchises douanières qui lui permettaient de maintenir sa position économique. Il était en deuxième position sur la liste des gens les plus fortunés du pays. L’ingérance récidivante de mon père dans la politique du pays était en vrai une gangrène qui grignotait les différentes couches sociales du pays. Le peuple n’en pouvait plus visiblement. Intérieurement, je me réjouissais quand je voyais cette débâcle, cette anarchie, cette image machiavélique peint sur une toile triviale par une politique corrompue. Un chef d’œuvre de deux siècles de cacateries. Tout cet inconfort inhumain m’était profitable, il servait à mettre de la nourriture dans mon bol, à me commander des vêtements de grandes marques, à faire la fête, à être cette fille d’Instagram sur laquelle se jetait le dévolu sexuel des jeunes males. Ces pauvres petits messieurs bêtes comme un manche qui rêvassaient de coucher avec moi, la sublime. Moi, héritière d’une compagnie qui trafiquait leurs avenirs, hypothéquait leurs chances et qui tôt ou tard allait les obliger à s’immigrer loin de leurs familles. Comme ils pouvaient être ridicules ces gens. Je m’en foutais carrément d’eux.
Il y avait ce bar dans lequel je me retrouvais avec des amis à faire la fête. Il était situé dans les hauteurs et c’était plus aisé pour les gens qui possédaient des voitures de la fréquenter. Il n’était pas permis à tout le monde de posséder une voiture dans ce pays, tout n’était que luxe pour celui qui était un salarié de l’Etat. J’eus ouï-dire qu’ils faisaient partie de la classe moyenne. Je me demandais si tout cela n’était pas de la folie. Pire encore pour ceux-là qui sont des chômeurs aguerries. Je les plaignais tellement. Ce bar était mon échappatoire quand je voulais fuir un père qui ne cessait de me sermonner sur ma négligence et pour mes gouts. J’étais appelé à prendre les commandes à sa mort (une autre raison d’avoir peur de celle-ci) et je n’avais pas la tête à cela. Je voulais que vivre ma vie, voyager et m’en foutre du reste du monde. Je me laissais aller dans ce coin un peu sombre, des tubes d’électro défonçant à haut décibels les murs en briques, fumant ma cigarette, une prélude pour émoustiller le poumon avant de s’attaquer aux chichas, ensuite venait des bouteilles de rhum et de whisky fabriqués au quatre coins du monde. Je rentrais en transe, à ma quatrième bouteille, j’arrive rarement à dépasser la quatrième bouteille. A la moitié de celle-ci, je soulevais une voile, la voile de l’impudeur. Je commençais par me tortillonner, me trémousser dans tous les sens en enlevant un par un mes vêtements, je me mettais à flirter avec des mecs dont je ne connaissais pas. Leurs mains, comme des pattes d’araignées, baladait sous mes cuisses nues, pour ensuite se perdre derrière le tissu de ma culotte. Ensuite, une séance de sniffage était la bienvenue, cela classait les souvenirs par ordre dans ma tête et cela me donnait en passant une once de lucidité. On ne se la pétait pas cool tant qu’on n’introduisit pas un peu de coke dans notre système. C’était illégal mais j’avais pu remarquer que les trucs interdits étaient les plus excitants. Mon aventure se terminait souvent aux premières heures du jour, dans une orgie monstrueuse de petites putes perdues dans un bar. Et j’oubliais le lendemain que j’avais fait l’amour avec des femmes. Rien ne se perd, tout s’obtient quand il y a une caméra.
Cette semaine, j’aurais dû rentrer à Miami pour entamer mes études en droits internationales mais j’ai été empêché. Le pays était subitement mis en mode pause. Toute activité cessa dans la ville et dans tout le pays, des barricades furent dressés et des caoutchoucs enflammés entravaient les rues à chaque croisée. Mon père ne voulait pas que je sorte. C’était la première fois que je le voyais si angoissé. Il avait peur. Il m’a distillé sa peur, j’avais peur à mon tour. Pour la première fois de ma vie, je me sentais inconfortable dans ce pays. « Des gens malintentionnés ont réveillé les sous-hommes, ils leur ont montré ce qu’ils étaient vraiment, ils leur ont ouvert les yeux. Sais-tu ce qui arrive aux zombies lorsqu’on leur donne du sel ? » Je ne savais pas quoi répondre, je ne connaissais pas les contes urbaines locales, je connaissais mieux les contes de Perrault et des Frères Grimm que l’histoire du pays. « Ils deviennent fous poursuivit-il en roulant des yeux fous à son tour, vois ce qu’ils font, ils détruisent, ils brulent, ils harcèlent, ils tentent de changer leur sort. Ils veulent attaquer notre bastion ma fille, nous ne sommes plus en sécurité ici. »
Je passais trois semaines fermées à double tour chez moi. Non pas que je ne pouvais pas sortir mais mon père m’avait inculqué sa peur et involontairement je sentais que mon confort était la cause de cette dégénérescence. J’ai appris plus tard qu’un bidonville a subi des assauts meurtriers, des gens ont été massacrés, des maisons brulées. La peur se propageait dans les hauteurs et la plupart des gens de notre classe commençait par faire leurs valises. Mon père ne voulait pas abandonner le président très contesté par la populace.
Une autre nouvelle nous parvient, un autre quartier populaire a subi des razzias menées par des gangs, un peu avant l’aube. Des dizaines de femmes violées. Je pouvais tout accepter sauf cela. Le viol. J’essayais de m’imaginer en train d’être violé, c’est aussi pire que la mort. Les rumeurs circulent bon train, on menaça de venir ébouillanter notre paisible petite vie acquise scrupuleusement sur la selle de leurs misères. En fait c’est ce qu’ils disaient. Moi j’appelais ça tout simplement de l’intelligence sociale. Y a eu un petit groupe qui a été assez intelligent pour faire du profit sur un autre. Comment ont-ils procéder pour faire ce profit ? Je fermais les yeux dessus et savourait tout simplement les bénéfices de ce résultat faramineux.
Je suivais les actualités sur les réseaux sociaux, les gens parlaient peu du massacre des bidonvilles comme si ces gens méritaient ce qui leurs étaient arrivés. J’etais abasourdie. Les gens qui font partie des classes plus basses se croient meilleurs que les uns des autres alors qu’ils pataugent ensemble dans la même fange. Ils se détruisent entre eux sans penser à se liguer contre leurs ennemis communs : mon père et les autres. Oui, je savais que mon père n’était pas une saint-nitouche mais je fermais les yeux car avoir tout ce que l’on veut en un simple claquement de doigt est tellement féerique.
La semaine suivante, on brula une voiture dans les rues de Pétionville, un HUMMER flambant neuf. Cela défraya la chronique et les réseaux sociaux.
Je ne pouvais plus vivre au milieu de cette gaguère à ciel ouvert, on dirait qu’ils étaient en train de subir. Selon l’ordre des choses, pour éviter l’extinction, les caractères les plus forts survivaient pour ensuite se reproduire mais dans ce cas-ci, c’était la bêtise qui pullulait. J’aimais les voir ainsi. Ce n’est pas que je prenais pitié pour les gens des quartiers populaires, je m’en battais carrément l’utérus. Mais je voulais voir si les gens dont m’avait tant parlé mon père allaient faire front uni pour reprendre ce qui leur a été volé. Mais ils étaient en train de donner raison à mon père. Il y eut une discussion sur la répartition des richesses sur les réseaux, on attaqua violemment ma famille, mon père m’avait interdit de faire des commentaires, j’ai été surprise de voir mes amies défendre l’héritage de mon père bec et ongle, mieux que l’aurait fait les avocats de la famille, mieux que l’aurait fait moi-même. Des lèche-bottes jusqu’au talon. Il était temps que je foute le camp de cet endroit.
Le lendemain, je laissai le pays. Je traversais la frontière. J’avais l’intention de passer Noël en République Dominicaine. Mes statuts d’Instagram affichaient mes visites aux grands centres commerciaux de la ville hispanique, mes différentes escapades nocturnes dans les discos latinos, capture en boomerang de tranches de pizza juteux. Je vivais pleinement ma vie de bonne petite fille fortunée. Ce n’est pas de ma faute si les autres n’ont pas eu cette chance.
Quatre ans plus tard, j’avais oublié qu’il existait un endroit qui s’appelait Haïti, j’avais perdu de vue mes origines pour embrasser le monde européen avec des bras de géants. La nouvelle me parvint un soir alors que je sortais d’une réunion avec des potentiels donateurs pour mon projet. Toutes les chaînes internationales la diffusaient : « Pétionville est tombée sous le contrôle de gangs armés : tuerie en masse ». J’eus une pensée pour mon père, je saisis mon téléphone et appela la maison, pas de réponse. Je contactais des amies dont je n’avais adressé la moindre goutte de parole depuis quatre ans, ils m’apprirent sans ménagement la nouvelle, mon père est en cavale, tout le bien de ma famille était en train d’être dilapidé par des gens du peuple. Ces gens qu’il méprisait tellement. Prise d’étourdissement, je me laissais choir sur le canapé tandis qu’à la TV, un journaliste de la CNN était en train de commenter : « L’inégalité dans la répartition des richesses ont été des charbons ardents qui ont conduit à ce soulèvement radical de la masse. Le pouvoir n’a pas su combler les attentes, ils ont préféré utiliser la bonne vieille méthode de la crainte. Nombreux sont ceux qui affirment que le pouvoir est impliqué dans la distribution des arsenaux militaires dans les quartiers populaires… »
Le reste de ces paroles m’étaient devenus incompréhensibles, le malheur qu’avait déclenché dans leurs imprudences les gens de mon rang, avait fini par avoir raison d’eux. Ils ont perdu le contrôle et maintenant le malheur est monté jusqu’à eux. Moi, j’étais hors de danger, emmitoufler dans mes couettes pendant que le ciel jetait un manteau blanc de neige sur la ville de Paris. Quelque part, le malheur était en train de frapper.
Télécharger gratuitement nos recueils>>Recueil
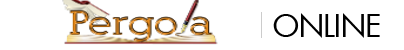




A chaque fois @eder tes mots me donnent un bon coup de fouet comme si j’étais endormie. Mais cette description des gens noirs c’est de la méchanceté gratuite. Je sais que cest pour coller au personnage mais quand même c blessant. J’apprécie énormément tes coups de plume.??
Je n’ai rien d’autre à dire que « parfait ». C’est l’une des rares sinon la seule de tes écrits qui ne soit pas érotique. Et je dois avouer que tu fais aussi des étincelles avec ce type d’écriture. Tu as bien su faire vivre ton personnage : j’ai bien senti son mépris et sa froideur, et même un peu de ce vide caractéristique des gosses de riches. Juste une question : n’y aurait-il pas un peu d’anticipation dans ton récit? Personnellement, je pense que cette fictive réalité n’est pas loin de se réaliser.