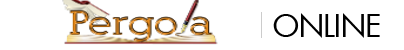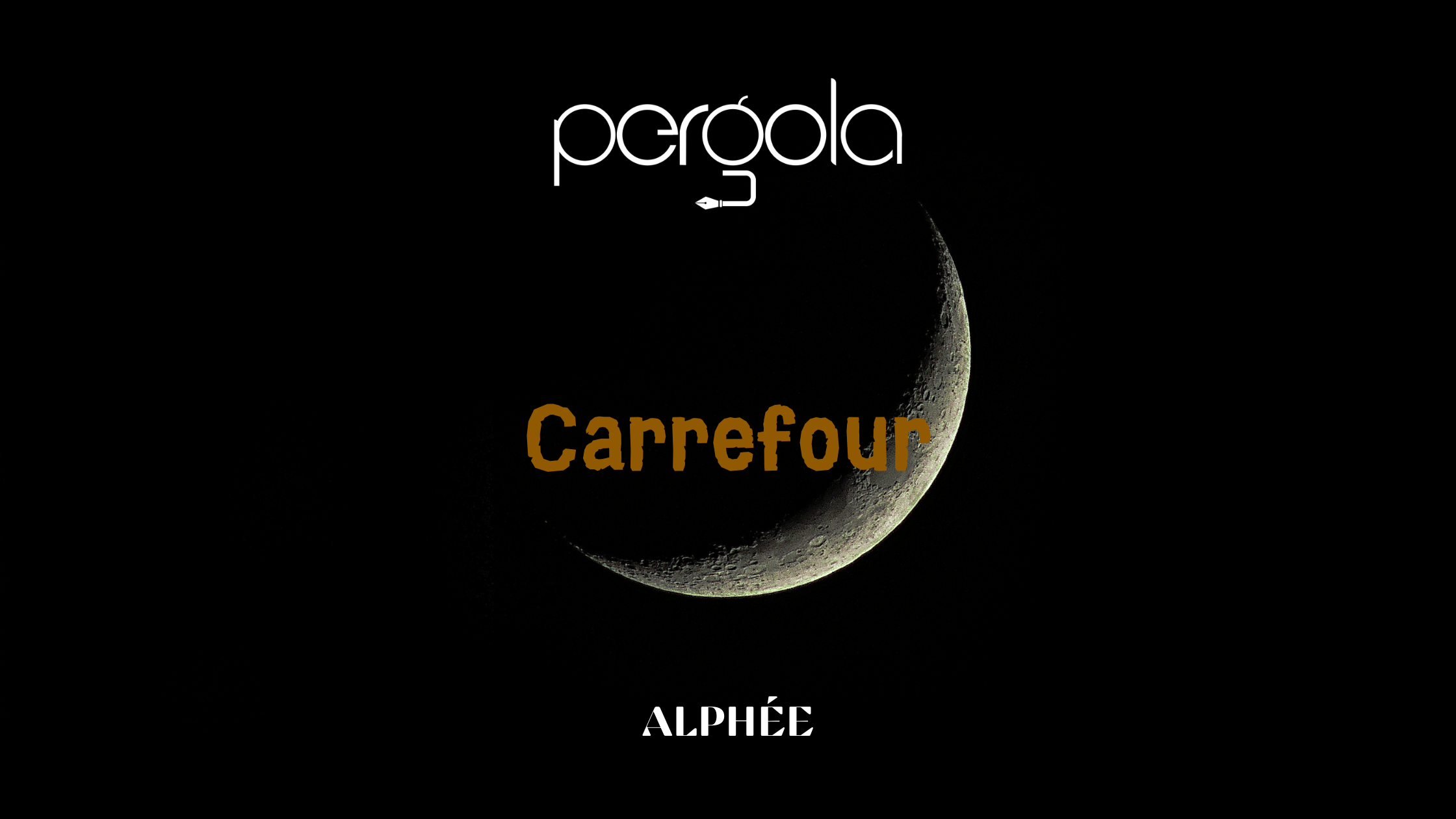CARREFOUR
J’ai toujours eu peur du noir, mais ça, c’était avant. Avant ce carcan. Avant la peur de marcher le jour. Avant l’odeur du massacre embaumant l’air port-au-princien. Avant la terreur dans les yeux des enfants. Maintenant, le noir est mon refuge. Mes soirées sont délicieuses, je sors toujours pour contempler le firmament, la lune solitaire, la splendide constellation. Je respire et je sens la vie parcourir mes veines. L’air frais pénètre mes poumons et je jette mes pensées de la veille. Ainsi je vide mon réservoir de soucis quotidiens dans la nuit sombre et mystérieuse.
Il est vingt-trois heures, je traverse la rue Oswald Durand. J’ai été retenue par une orageuse pluie du Sud, qui a fait déserter les asphaltes par les marchandes.
La rue est vide et silencieuse, une douce brise me caresse l’âme. Troublée et incertaine. Je respire l’amertume, j’entends au fond de moi leur voix suppliant leur vie, le cri de la mort.
La pluie laisse derrière elle : l’odeur de la mort, la pestilence de la terre remonte à moi jusqu’à me donner le vertige. Je ne pourrai jamais m’habituer à l’odeur des morts. Malgré, chez nous, la mort on la vit.
Je vois des visages d’amour avec une lueur d’espoir, demain sera mieux se disent-ils. Mais ce demain n’arrive jamais. Je vois de jeunes âmes innocentes face à la réalité inhumaine.
Je descends le long de la rue Saint-Honoré. Je passe devant l’hôpital général qui pue la maladie et la désolation. L’hôpital, c’est le couloir de la mort comme le dit le rap de ce jeune artiste poète et révolté.
Je traverse la rue Monseigneur Guilloux, la rue est calme et les chauffeurs de moto ne sont plus là. La pluie a ce pouvoir de tout faire déserter.
Je descends, le sang froid. Je passe près du fou qui range son lit. La pluie perturbe aussi les demeures.
J’habite cette rue avec ma mère, Marie Claire. Une femme courageuse. Elle ne se plaint jamais, et encaisse les coups de la vie. Le séisme m’a enlevé mon père, insouciant de ses actes. La vie a décidé. « BonDye bay, BonDye pran, se pou volonte li fèt », On s’habitue à tout et trop vite ici, même l’insécurité. On reste fidèle à nos vieilles traditions, tout en acceptant de nouvelles. On reste fidèle à notre misère, on caresse notre crasse de peur qu’elle s’en aille. Ce sentiment d’appartenance.
La vie est cette cruelle qui te tend la main, t’a vu naître et t’aide à grandir. Elle te tend la main et t’aide à faire tes premiers pas. Elle t’accompagne, et elle sourit de ton innocence et de ta naïveté. Elle t’aide à sourire, ton insouciance la charme. Elle t’assiste, te vois grandir. Au final, tu deviens amoureuse. Tu commences à aimer la vie, à donner un sens à ton existence. Rêver, rire, causer. Elle sourit, la vie. Elle te regarde grandir. Après, elle te tue un peu plus chaque jour. Tu commences à la questionner, elle s’en moque. Elle te blesse. Elle te poignarde, elle te mutile. Elle te persécute, te tend des pièges. Le poids de la vie te ronge puis tout ce qui te reste c’est le vide. Un vide. Vide de désirs, d’émotions. Vide.
Vivre en Haïti, n’est pas un cadeau. Ça on peut le dire. On porte en nous la peur de nos compatriotes massacrés, l’insécurité. La peur nous ronge et la vie nous détruit. La nuit ne nous conseille plus. On espère tous.
Je marche sereine, pas comptés, sûre de moi. Sûre d’être celle que je m’efforce d’être. Je suis personne. Je suis juste un mot. Un mot perdu. Qui cherche sa voie. Un mot insensé cherchant du sens avec d’autres mots. Un mot. Je ne suis pas la vie, je suis ce qui nous reste de la vie. Je ne suis pas la mort, je suis son tourment. Je suis un mot.
Je suis désolée de voir des âmes partir si jeunes à cause de l’égoïsme des plus vieux. Je suis désolée de voir infliger l’abjection et son goût amer aux enfants. Je suis désolée pour cette dose de terreur. Leur innocence et leur insouciance sont parties, adieu l’enfance.
La peur est une partie de moi. Un bout de moi. Aussi bien que ma joie perdue, mon existence meurtrie .
Aujourd’hui, je ne sais plus ce que je vis, je n’ai ni peur, je ne suis pas forte non plus. Je ne ressens rien, je ne capte rien. Le monde s’écroule autour de moi. Le sang des innocents coule sous mes pieds. Fermer les yeux, courir. Partir. Aller loin. Loin de tout. De cette terreur. Loin du massacre. Je me mens. Je ne pourrai fuir. La réalité me rattrapera. Je noie ma peur dans l’alcool. Je pense les faire partir en fumée avec ma cigarette. Et je me mens. L’odeur de mes adelphes massacrés, me suit. J’ai l’horrible impression de me noyer en moi, de me perdre en moi.
Ce soir, je sens l’odeur infecte venir de devant, une odeur de nécrose. La pestilence de notre mal venait de me frapper. Pensai-je. La puanteur persiste et me bat en plein poitrine. J’ai le vertige. Je m’arrête, jette un coup d’œil autour de moi. Je suis seule, la rue est noire. Le fou dort déjà. Je sens encore cette odeur nauséabonde qui devenait de plus en plus insupportable.
Arrivant au Carrefour : entre la rue St Honoré et la rue de la Réunion, j’aperçois un animal à quatre pattes : dégageant ce relent embaumé d’épices pourries. Géant, pour un chien. J’avance, mine de rien : « ou nan wout ou mwen nan wout mwen ». Regards humains, Cornes de taureau, pattes de chien, hauteur de cheval. Son regard humain-prédateur me fixe jusqu’à me transpercer. Fort et redoutable, j’entends sa respiration. Mon rythme cardiaque augmente. Je reste figée, je tremble. Mon tee-shirt est trempé comme s’il pleuvait. Il me fixe de ses yeux rouges. J’entends sa respiration m’approcher, son odeur me pétrifier. Mes pieds deviennent moites, je ne peux ni avancer ni reculer. La bête s’impose. J’ai voulu crier au secours, mais tout le monde dort. La rue est déserte et son silence est perturbé par l’aboiement des chiens. Il y a aussi la présence d’une créature mystérieuse, qui semble admirer ma peur.
Je pense faire demi-tour, et passer par les rues avoisinantes. Il est trop tard, je ne peux plus bouger, ni crier au secours. Je reste figée.
J’entends la bête hurler. Mon cœur bat au rythme de son cri. Je la vois pousser des ailes lumineuses, puis s’envoler telle une chauve-souris géante. Elle monte le long de la rue saint-honoré en émettant un son aigu et pénétrant.
Je cours de toutes mes peurs, traversant l’espace qu’elle occupait quelques secondes plutôt. Son odeur persiste encore. Je rentre chez moi, tremblante. Couchée, avec les tenues de la peur. Je l’entend crier sur mon toit. Le son pénètre mon âme. Un coup sec se retentisse. La nuit est plongée dans le silence le plus total. J’entends quelqu’un murmurer quelque chose. J’entends le son à nouveau, puis il s’éloigne tel un oiseau battu. Je ferme mes yeux cachant ma peur sous mes draps.
Demain matin, mon voisin Ti Pòl raconta l’histoire de partout : « je l’ai vu venir. Mais cette fois je l’attendais. Elle mourra avant trois jours, cette sorcière».
Le jour suivant, Sò Jàn est morte de cause inconnue. Son corps puait comme lors de la transformation de la créature mystérieuse. Les funérailles eurent lieu, dans l’après-midi. Son odeur embaumait les deux pièces de Jeannette, sa benjamine.
«Nou va resi gen lapè ak lougawou sa » chantait en cœur les autres à son enterrement.
Lire aussi>> Repertum
Alphée